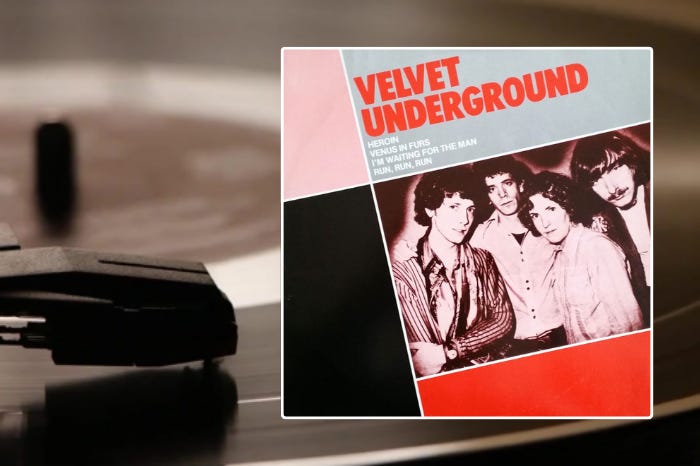Heroin : l'ascension vers le néant
New York, 1967. Tandis que San Francisco s’étourdit de fleurs et de psychédélisme acidulé, le Velvet Underground injecte du poison dans le rêve hippie.
“Heroin” n’est pas une chanson ; c’est un rite de passage, un monolithe de sept minutes qui défie la morale de l’époque.
Tout repose sur une tension insoutenable. Deux accords seulement, Do et Fa, qui s’étirent comme une artère sous pression. La batterie de Maureen Tucker refuse la syncope pour un battement de cœur primitif, métronomique, qui s’accélère jusqu’à la tachycardie. Puis, l’alto électrique de John Cale déchire le mix : un cri de métal hurlant qui simule la montée, le flash, puis la chute brutale.
Lors des sessions aux studios Scepter, l’ingénieur du son, déconcerté par ce vacarme avant-gardiste, aurait quitté la régie en plein enregistrement. Pour lui, ce n’était que du bruit. Pour Lou Reed, c’était la réalité nue. Il voulait capturer ce moment précis où le monde extérieur s’efface pour ne laisser place qu’à un sentiment de puissance absolue et de solitude totale.
Heroin reste pour moi la pièce la plus honnête de l’histoire du rock. Elle possède cette beauté abrasive des choses qu’on ne peut pas détourner du regard. C’est une cathédrale de verre brisé. Écouter ce morceau, c’est accepter de perdre pied, loin des mélodies faciles, dans l’ombre portée d’un génie qui préférait la vérité à la radio.